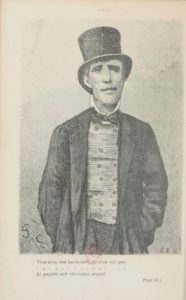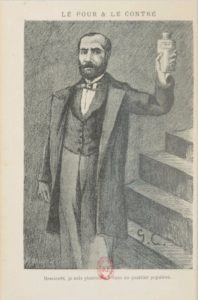| En 1866, Zola fustige le jury qui a mis les réalistes à la porte du Salon, en particulier Manet et Brigot, un peintre aujourd’hui complètement oublié. Pour la première fois, il nomme Courbet dont il regrette l’évolution voire les reniements :
Je […] constat[e] ici, et personne n’osera me démentir, que le mouvement qu’on a désigné sous le nom de réalisme ne sera pas représenté au Salon. Je sais bien qu’il y aura Courbet. Mais Courbet, paraît-il, a passé à l’ennemi. On serait allé chez lui en ambassade, car le maître d’Ornans est un terrible tapageur qu’on craint d’offenser, et on lui aurait offert des titres et des honneurs s’il voulait bien renier ses disciples. On parle de la grande médaille ou même de la croix. Le lendemain, Courbet se rendait chez M. Brigot, son élève, et lui déclarait vertement qu’« il n’avait pas la philosophie de sa peinture ». La philosophie de la peinture de Courbet ! Ô pauvre cher maître, le livre de Proudhon vous a donné une indigestion de démocratie. Par grâce, restez le premier peintre de l’époque, ne devenez ni moraliste ni socialiste. Mon Salon – L’Evénement, le 30 avril 1866 |
||||||||||||||
| Zola associe fréquemment le nom de Manet à celui de Courbet comme ceux de deux tempéraments puissamment originaux dans leur différence même :
« Nos pères ont ri de Courbet, et voilà que nous nous extasions devant lui ; nous rions de Manet, et ce seront nos fils qui s’extasieront en face de ses toiles. » Mon Salon – L’Evénement, 4 mai 1866 « La place de M. Manet est marquée au Louvre comme celle de Courbet, comme celle de tout artiste d’un tempérament original et fort. D’ailleurs, il n’y a pas la moindre ressemblance entre Courbet et M. Manet, et ces artistes, s’ils sont logiques, doivent se nier l’un l’autre. C’est justement parce qu’ils n’ont rien de semblable, qu’ils peuvent vivre chacun d’une vie particulière. » Mon Salon – L’Evénement, 7 mai 1866 |
||||||||||||||
| Le jugement de Zola n’est jamais complaisant ; dans cet article intitulé Les Chutes, il exécute d’un mot le maître d’Ornans pour mieux le rappeler à lui-même ; à ses yeux, Courbet « a fait du joli » pour être reçu au Salon, une lâcheté indigne du grand réaliste qu’il fut :
Il y a, en ce moment, une excellente comédie qui se joue, au Salon, en face des tableaux de Courbet. Ce que je trouve de plus curieux à étudier, même au point de vue de l’art, ce ne sont pas toujours les artistes, ce sont souvent les visiteurs qui par un seul mot, par un simple geste, avouent naïvement où nous en sommes en matière artistique. Il est bon parfois d’interroger la foule.
Cette année, il est admis que les toiles de Courbet sont charmantes. On trouve son paysage exquis et son étude de femme très convenable. J’ai vu s’extasier des personnes qui, jusqu’ici, s’étaient montrées très dures pour le maître d’Ornans. Voilà qui m’a mis en défiance. J’aime à m’expliquer les choses, et je n’ai pas compris tout de suite ce brusque saut de l’opinion publique. Mais tout a été expliqué, lorsque j’ai regardé les toiles de plus près. Je l’ai dit, la grande ennemie, c’est la personnalité, l’impression étrange d’une nature individuelle. Un tableau est d’autant plus goûté qu’il est moins personnel. Courbet, cette année, a arrondi les angles trop rudes de son génie ; il a fait patte de velours et voilà la foule charmée qui le trouve semblable à tout le monde et qui applaudit, satisfaite de voir, enfin le maître à ses pieds. Je ne le cache pas, j’éprouve une intime volupté à pénétrer les secrets ressorts d’une organisation quelconque. J’ai plus souci de la vie que de l’art. Je m’amuse énormément à étudier les grands courants humains qui traversent les foules et qui les jettent hors de leurs lits. Rien ne m’a paru plus curieux que ce fait d’un esprit puissant, admiré justement le jour où il a perdu quelque chose de sa puissance.
J’admire Courbet, et je le prouverai tout à l’heure. Mais, je vous prie, reportez-vous à cette époque où il peignait La Baigneuse (1) et Le Convoi d’Ornans, et dites-moi si ces deux toiles magistrales ne sont pas autrement fortes que les deux délicieuses choses de cette année.
Et pourtant, au temps de La Baigneuse et du Convoi d’Ornans, Courbet prêtait à rire, Courbet était lapidé par le public scandalisé. Aujourd’hui, personne ne rit, personne ne jette des pierres. Courbet a rentré ses serres d’aigle, il ne s’est pas livré entier, et tout le monde bat des mains, tout le monde lui décerne des couronnes. Je n’ose formuler une règle qui s’impose forcément à moi : c’est que l’admiration de la foule est toujours en raison indirecte du génie individuel. Vous êtes d’autant plus admiré et compris, que vous êtes plus ordinaire. Mon Courbet, à moi, est simplement une personnalité. Le peintre a commencé par imiter les Flamands et certains maîtres de la Renaissance ; mais sa nature se révoltait, et il se sentait entraîné par toute sa chair – par toute sa chair, entendez-vous ? – vers le monde matériel qui l’entourait, les femmes grasses et les hommes puissants, les campagnes plantureuses et largement fécondes. Trapu et vigoureux, il avait l’âpre désir de serrer entre ses bras la nature vraie ; il voulait peindre en pleine viande et en plein terreau. Certes, je ne puis être accusé de mesurer l’éloge au maître. Je l’aime dans sa puissance et sa personnalité. Il m’est permis de lui montrer la foule qui se groupe autour de ses toiles et de lui dire : Je ne nie point que La Femme au perroquet ne soit une solide peinture, très travaillée et très nette ; je ne nie point que La Remise des chevreuils n’ait un grand charme, beaucoup de vie ; mais il manque à ces toiles le je ne sais quoi de puissant et de voulu qui est Courbet tout entier. Il y a douceur et sourire. Courbet, pour l’écraser d’un mot, a fait du joli !
On parle de la grande médaille. Si j’étais Courbet, je ne voudrais pas, pour La Femme au perroquet, d’une récompense suprême qu’on a refusée à La Curée et aux Casseurs de pierres. J’exigerais qu’il fût bien dit qu’on m’accepte dans mon génie et non dans mes gentillesses. Il y aurait pour moi je ne sais quelle pensée triste dans cette consécration donnée à deux de mes œuvres que je ne reconnaîtrais pas comme les filles saines et fortes de mon esprit. Mon Salon – L’Evénement, 15 mai 1866 |
||||||||||||||
| Rien n’est amusant comme l’attitude de la critique à l’égard de Courbet. Le maître est loin d’être accepté ; on le tolère tout au plus ; on se défie de lui, on semble toujours redouter une mauvaise plaisanterie de sa part. Chaque année, les salonniers se tâtent, se consultent, se demandent s’ils peuvent risquer un éreintement ou un éloge. Pas un d’eux ne paraît se douter que, lorsque Courbet faiblit, il reste encore un des premiers peintres de l’époque. Quelle pauvre critique que cette critique courante des journaux qui jugent une œuvre mesquinement, une loupe à la main, sans jamais voir la personnalité large de l’artiste ! Un tableau plus ou moins réussi ne signifie rien quand on le prend à part ; il faut considérer le tempérament d’un homme dans son entier, sa force créatrice, les qualités rares et individuelles qui en font un maître original. Il m’importe peu qu’une toile soit moins complète, il me suffit de retrouver, dans cette toile, l’accent particulier d’un esprit puissant et souple. Les œuvres voisines peuvent être parfaites, leur perfection sera vide de cet accent-là, et dès lors ces œuvres me paraîtront écœurantes de médiocrité. Dire qu’il y a des gens qui n’ont pas assez de mépris pour Courbet, et qui se vautrent ensuite d’admiration devant les sucreries de certains peintres ! Ces braves gens sont des idéalistes quand même ; ils sont satisfaits, non pas du talent de l’artiste, mais de la reproduction éternelle de lignes qui leur plaisent. Alors, ils lâchent le robinet tiède de leurs phrases, ils oublient qu’ils viennent de donner le fouet à un maître, et ils distribuent des friandises à de misérables élèves, à des copistes de quatre sous. Eh ! Sachez qu’un coup de pinceau de Courbet, si rude et si faux qu’il soit, vaudra toujours mieux que tous les tableaux mis en tas des peintres à succès.
Cette année, Courbet n’a pas été heureux avec la critique. Son tableau, L’Aumône d’un mendiant à Ornans, a été quelque peu traîné dans la boue par les idéalistes en question. Les faiseurs de phrases pittoresques, ceux qui parlent peinture comme des artificiers, en allumant une fusée à chaque virgule, ont déclaré que le maître était devenu gâteux. D’ailleurs, l’année prochaine, ils ne se souviendront plus d’avoir dit cela et ils lui trouveront peut-être beaucoup de talent. La vérité est que le tableau du présent Salon est très lumineux ; s’il n’est pas d’une peinture aussi solide que les anciennes toiles de l’artiste, il est encore bâti à chaux et à sable comparé aux toiles encensées par la critique. Entendons-nous, je ne suis pas assez proudhonien pour accorder une larme au sujet et m’extasier sur la philosophie doucement humanitaire de Courbet. Je n’ai jamais vu en lui qu’un faiseur de chair ; je le loue comme artiste individuel, laissant à d’autres le soin de le louer comme moraliste. Courbet cherche à faire blond depuis quelque temps.
La jeune école, qui voit la nature par taches claires, lui a fait abandonner, sans doute à son insu, sa manière noire, celle du Convoi d’Ornans et de La Fileuse. Je ne sais, si j’avais un conseil à lui donner, je lui dirais de revenir à sa première façon de voir. Son talent a une ampleur et une sévérité qui s’accommodent mal des gaietés blondes de la nature. J’avoue n’aimer que médiocrement ses dernières marines, très fines, il est vrai, mais un peu minces pour sa rude main magistrale. Mon Salon (1868) – Quelques bonnes toiles -L’Evénement illustré, le 9 juin 1868 |
||||||||||||||
J’ai entre les mains un livre singulier et intéressant, dont personne n’a encore parlé, et qui sera la curiosité de la semaine prochaine. Il s’agit d’une œuvre de M. Étienne Baudry, Le Camp des bourgeois, illustré par Gustave Courbet. Là est la grande attraction du volume. Le maître d’Ornans fait ses débuts dans l’illustration. C’est la première fois qu’il consent à travailler pour la librairie. Son talent, rude et solide, s’accommode assez mal des délicatesses de la gravure. Je connais bien un autre petit livre illustré par lui, un recueil de poésies de Max Buchon. Je crois qu’il n’existe plus que deux ou trois exemplaires de cette rareté. Courbet devait avoir dix-sept ou dix-huit ans lorsqu’il a fait les dessins qui se trouvent dans ce recueil. Ce sont des amoureux et des amoureuses se promenant dans des bocages, vêtus des vêtements étriqués à la mode vers 1840.
Le peintre des Casseurs de pierres était alors en pleine idylle, il ne songeait guère à la peinture humanitaire et démocratique que Proudhon a inventée plus tard pour son usage. Si vous rencontrez jamais les poésies de Max Buchon, feuilletez-les ; vous passerez un excellent quart d’heure à regarder les balbutiements d’un talent qui s’ignorait encore et qui se perdait dans une sentimentalité devenue grotesque aujourd’hui.
Pour en revenir au livre de M. Étienne Baudry, c’est là une œuvre qui fera sensation. L’auteur est un utilitaire tombant à bras raccourcis sur la bourgeoisie fainéante et oisive. Il appelle « bourgeois » tous les inutiles qui ne travaillent pas, et, comme il veut que tout le monde travaille, il sonne le glas de messieurs les propriétaires. Des paysans, rien que des paysans, tel est son rêve.
Le volume aurait pu s’intituler : L’Art de se servir soi-même. Ce qui exaspère M. Baudry, c’est que nous ayons besoin de domestiques pour vivre. Il prétend qu’on peut se suffire, il cherche par exemple à prouver aux dames qu’elles n’ont pas besoin de cuisinière pour écosser des pois, ni de chambrière pour mettre leur corset. Je doute qu’il persuade cela à certaines coquettes de ma connaissance. Fi ! l’horreur ! éplucher des légumes ! Je n’ai pas ici la place nécessaire pour trancher des questions si graves. Plus de domestiques ! mais le monde serait bouleversé. Je laisse la parole aux philosophes et aux moralistes. Courbet ne pouvait guère trouver un texte dont l’esprit convînt mieux à son genre de talent. Le Franc-Comtois a dû se réjouir en lui de ce plaidoyer en faveur des paysans, des rudes enfants de la terre. Aussi, comme il s’est mis volontiers à dauber les bourgeois, les messieurs qui ne sauraient distinguer une pelle d’un râteau ! Chacun de ses dessins est une satire. Il me semble que j’entends sa parole grasse, son rire épais, écrasant de son mépris les riches imbéciles qui ne comprennent pas la « bonne peinture » – la sienne. J’ouvre une parenthèse, pour y glisser un mot du maître. Un de mes amis l’entendait dernièrement donner une définition du talent d’un peintre accablé d’honneurs et de commandes, dont la peinture rose et blanche est un régal pour les personnes qui aiment les confitures… » Vous voulez faire une Vénus pareille à celle de X…, n’est-ce pas? disait Courbet. Eh bien ! vous peignez avec du miel une poupée sur votre toile ; puis, vous emplissez un goupillon de farine, et, légèrement, vous aspergez la poupée. C’est fait. » Un homme qui a si peu de respect pour la peinture académique, doit être terrible pour M. Prudhomme.
Dès la première page du Camp des bourgeois, il nous montre l’immortel Joseph relevant les sourcils dans une grimace grosse d’importance et de bêtise. Un peu plus loin, se trouve le fils du bourgeois, un collégien qui a une large mâchoire de crétin. Puis vient l’épouse, puis toute la famille. On dirait un défilé de fœtus conservés dans du vinaigre. Je recommande particulièrement le chapitre où Courbet expose lui-même ses théories sur les destinées de l’art. Je regrette vivement de ne pouvoir citer ce chapitre en entier. Le maître y déclare carrément qu’il faut fermer les musées et les remplacer par les gares de chemin de fer. Personne ne va plus au Louvre, tandis que tout le monde voyage de temps à autre, quand ça ne serait que pour aller manger une friture à Asnières. C’est donc dans les salles d’attente qu’il faut maintenant accrocher les tableaux. Entendez-nous : il s’agit des tableaux de l’école nouvelle. Quant aux anciens, on peut les brûler. Il faut que les galeries soient une histoire du travail, qu’elles représentent les productions, les industries, les ouvriers des différentes contrées. « On se morfond chez eux, s’écrie Courbet en s’adressant à un administrateur, quand on pourrait s’y instruire, quand il vous suffirait de cacher sous de bons tableaux ces grandes murailles nues et désolées pour enseigner au peuple l’histoire vraie, en lui montrant de la vraie peinture. » Je veux apporter ma petite pierre à l’édifice. Courbet n’a peut-être pas encore songé que les Halles centrales offrent un développement de murs admirable et que la bonne peinture serait là au frais. Allons, à l’œuvre, artistes de l’avenir ! Peignez les différentes pêches, les mille espèces de poissons, racontez-nous les jours d’orage et les jours de calme de la grande mer. Nos bonnes et nos femmes, en allant au marché, ont besoin de voir un peu de vraie peinture ! Le Camp des bourgeois, illustré par Gustave Courbet L’Evénement illustré, le 5 mai 1868 |
||||||||||||||
| En 1875, Zola récapitule l’histoire de l’art de son temps et déplore que Courbet, fourvoyé à ses yeux dans l’aventure de la Commune, se soit coupé de son public. Reste que le peintre est pour lui l’un des rares talents originaux du XIX° siècle qui aient amorcé une véritable révolution dans le « tableau de figures », une révolution qui continue avec Manet mais attend encore le peintre de génie qui s’imposera en maître :
Tous les maîtres de notre époque sont morts. Voici déjà des années qu’Ingres et Delacroix ont laissé l’art en deuil. On les regrette toujours, car il n’y a personne pour les remplacer. Pour Courbet, qui a eu la bêtise impardonnable de se compromettre dans une révolte où il n’avait aucune raison de se fourrer, c’est comme s’il n’existait pas, il vit quelque part en Suisse. Voici trois ans déjà qu’il ne donne rien de neuf. Théodore Rousseau, Millet, Corot, les coryphées du paysage, se sont suivis coup sur coup dans la tombe. En quelques années, notre école moderne a été comme décapitée. Aujourd’hui, les élèves seuls demeurent. […] L’enfantement continu auquel nous assistons, s’il met au jour bien des œuvres avortées, n’en est pas moins une preuve de puissance. Il est beau de voir parmi nos désastres et nos bousculades politiques, une telle vitalité dans notre production artistique. J’ajoute que l’anarchie de l’art, à notre époque, ne me paraît pas une agonie, mais plutôt une naissance. Nos artistes sont, non pas des vieillards qui radotent, mais des nourrissons qui balbutient. Ils cherchent, même d’une façon inconsciente, le mot nouveau, la formule nouvelle qui aidera à dégager la beauté particulière de notre société. Les paysagistes ont marché en avant, comme cela devait être ; ils sont en contact direct avec la nature ; ils ont pu imposer à la foule des arbres vrais, après une bataille d’une vingtaine d’années, ce qui est une misère lorsqu’on songe aux lenteurs de l’esprit humain. Maintenant, il reste à opérer une révolution semblable dans les autres domaines de la peinture. Mais là, c’est à peine si la lutte s’engage. Delacroix et Courbet ont porté les premiers coups, Manet continue leur œuvre, mais la victoire, il faut l’avouer, n’est pas à prévoir dans un proche avenir. Il faudrait un peintre de génie dont la poigne soit assez forte pour imposer la réalité. Le génie seul est souverain en art. Une Exposition de tableaux à Paris -Lettres de Paris, juin 1875 |
||||||||||||||
| Hélas ! avec quelle joie ardente je me livrerais à l’enthousiasme pour quelque maître ! Mais je ne puis qu’évoquer les grandes ombres de Delacroix et d’Ingres, ces génies obstinés, disparus du monde sans avoir trahi leurs dons. Ces géants n’ont pas laissé d’héritiers, et nous attendons toujours les génies de l’avenir. Courbet, vieilli, chassé comme un lépreux, s’en va déjà à leur suite dans l’histoire. Lui aussi appartient dès aujourd’hui aux morts, aux artistes dont les tableaux seront éternels par leur force et leur vérité. Parmi les vivants, à peine un ou deux s’efforcent de se hausser au rang des créateurs.
Deux Expositions d’art au mois de Mai – Lettres de Paris, juin 1876 […] avant de parler des vivants, je vais évoquer le souvenir des dons magnifiques de ceux qui ont disparu dans ces dernières années et dont les œuvres sont exposées au Champ-de-Mars.
Au Champ-de-Mars, il n’y a qu’une toile de Courbet : La Vague, et même ce tableau n’y figure que parce qu’il appartient au musée du Luxembourg, et dès lors l’Administration des beaux-arts a bien été obligée de l’accepter. Et c’est cette toile unique que nous montrons à l’Europe, alors que Gérome dans la salle voisine ne compte pas moins de dix tableaux et que Bouguereau va même jusqu’à douze. Voilà qui est honteux. Il aurait fallu assigner à Courbet à l’Exposition universelle de 1878 toute une salle, comme on l’a fait pour Delacroix et Ingres à l’Exposition de 1855. Mais on sait bien de quoi il retourne, Courbet avait participé à la Commune de 1871. Les sept dernières années de sa vie ont été de ce fait un long martyre. On commença par le jeter en prison. Ensuite, à sa sortie de prison, il faillit mourir d’une maladie qu’avait aggravée le manque d’exercice. Après, accusé d’avoir été complice du renversement de la colonne Vendôme, il fut condamné à payer les frais de la reconstruction de ce monument. On lui réclamait quelque chose dans la région de trois cents et quelques mille francs. Lettres de Paris – L’Ecole française de peinture à l’Exposition de 1878 |