La collaboration entre Émile Zola et Alfred Bruneau
Les titres d’oeuvres en rouge permettent d’accéder à des extraits musicaux.
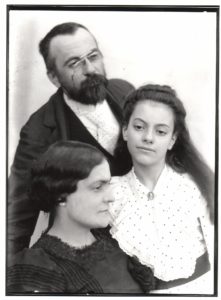
Alfred Bruneau est un jeune musicien, lorsque, le 1er avril 1888, il frappe à la porte d’Émile Zola : il n’a que 31 ans. Né d’un père musicien amateur (violoniste) et d’une mère peintre et élève de Corot, le jeune Bruneau pratique très vite le violoncelle. Au Conservatoire de Paris, il est l’élève de Massenet à qui il voue une admiration sans borne. C’est ainsi qu’il se forme à la composition jusqu’au prix de Rome dont il décrochera un second prix en 1881 (il n’y eut pas de premier prix cette année-là).
Kérim est son premier opéra qui rencontre un succès mitigé. En 1888, il écrit un Requiem d’une très grande beauté. Son projet, à cette époque, est de mettre en musique un roman de Zola : La Faute de l’abbé Mouret. Introduit chez Zola par l’architecte Frantz Jourdain (concepteur des nouveaux magasins de la Samaritaine), Bruneau rencontre l’homme qui sera son guide pendant une large partie de sa carrière. Zola regrette de ne pouvoir donner les droits de La Faute de l’abbé Mouret, cédés à Massenet. Il lui propose alors un autre roman pas encore paru : Le Rêve. Cet opéra sera créé en 1891 à l’Opéra-Comique sur un livret de Louis Gallet. La nouveauté de cet opéra réside dans le parti-pris réaliste des auteurs : action contemporaine, costumes modernes. Le public, d’abord dérouté, accueille de manière favorable cette œuvre qui fait date dans l’histoire de la musique lyrique en France.
Zola, séduit par cette expérience, propose à Bruneau de mettre en musique sa nouvelle des Soirées de Médan, « L’Attaque du Moulin ». Cet opéra, représenté en 1893, voit Zola collaborer de manière plus large. Il écrit même un poème connu sous le titre des « Adieux à la Forêt ». En quelques années, une amitié est née entre l’écrivain et le compositeur. Pour leur troisième œuvre commune, il vont se séparer de Louis Gallet. Zola devient librettiste. Il écrit Lazare, oratorio en un acte mis en musique seulement après sa mort, puis Messidor.
 Messidor, représenté en 1897, est la première tentative réussie d’opéra en prose. Bruneau accompagne le livret d’une musique aux résonances wagnériennes fortes et fait usage des leitmotive qui font de cet opéra une œuvre véritablement descriptive. Suivront alors L’Ouragan en 1901 et L’Enfant Roi en 1905. Après la mort de Zola, en 1902, Bruneau va continuer à puiser son inspiration dans l’œuvre du grand maître en mettant en musique La Faute de l’abbé Mouret, Naïs Micoulin et Les Quatre Journées de Jean Gourdon. Par la suite, Bruneau s’éloigne de Zola et compose notamment Angélo (d’après l’œuvre de Victor Hugo), Le Roi Candaule et Virginie en 1929, sa dernière grande œuvre théâtrale.
Messidor, représenté en 1897, est la première tentative réussie d’opéra en prose. Bruneau accompagne le livret d’une musique aux résonances wagnériennes fortes et fait usage des leitmotive qui font de cet opéra une œuvre véritablement descriptive. Suivront alors L’Ouragan en 1901 et L’Enfant Roi en 1905. Après la mort de Zola, en 1902, Bruneau va continuer à puiser son inspiration dans l’œuvre du grand maître en mettant en musique La Faute de l’abbé Mouret, Naïs Micoulin et Les Quatre Journées de Jean Gourdon. Par la suite, Bruneau s’éloigne de Zola et compose notamment Angélo (d’après l’œuvre de Victor Hugo), Le Roi Candaule et Virginie en 1929, sa dernière grande œuvre théâtrale.
Il faut compter également une centaine de mélodies et de nombreuses œuvres littéraires sur Massenet, la musique française ou les musiciens russes. Enfin, il ne faut pas oublier À l’ombre d’un grand cœur en 1932 qui est un fervent hommage à la mémoire de Zola. Dans ce récit de leur collaboration, Bruneau revient sur leurs moments d’intimité mais aussi sur leurs luttes pour la reconnaissance d’un opéra naturaliste et sur le drame de l’affaire Dreyfus dans laquelle Bruneau prendra une place non négligeable.
 Alfred Bruneau meurt en 1934. Compositeur atypique, admiré de ses pairs tels que Chabrier, Debussy, Lalo ou Fauré, ses œuvres furent dirigées par Gustav Mahler et Richard Strauss. Verdi lui fit part de vive voix de son admiration. Bruneau fut un compositeur omniprésent entre 1890 et 1930, intime des milieux artistiques mais aussi des politiques. Il mérite donc, aujourd’hui, d’être redécouvert tant pour l’audace de sa musique que pour sa collaboration fructueuse avec Émile Zola dont il fut l’ami, presque le frère. Une phrase de Zola, citée par Bruneau lui-même, résume cette fabuleuse collaboration :
Alfred Bruneau meurt en 1934. Compositeur atypique, admiré de ses pairs tels que Chabrier, Debussy, Lalo ou Fauré, ses œuvres furent dirigées par Gustav Mahler et Richard Strauss. Verdi lui fit part de vive voix de son admiration. Bruneau fut un compositeur omniprésent entre 1890 et 1930, intime des milieux artistiques mais aussi des politiques. Il mérite donc, aujourd’hui, d’être redécouvert tant pour l’audace de sa musique que pour sa collaboration fructueuse avec Émile Zola dont il fut l’ami, presque le frère. Une phrase de Zola, citée par Bruneau lui-même, résume cette fabuleuse collaboration :
« Même lorsque nous serons victorieux, l’avenir m’inquiète. On sera longtemps à nous pardonner d’avoir eu raison… »
Jean-Sébastien Macke
Voici une sélection de documents et d’articles de presse
concernant la collaboration d’Alfred Bruneau avec Émile Zola.
C’est le 30 octobre 1888 que la presse annonce, pour la première fois, l’intention du jeune compositeur Alfred Bruneau de porter sur la scène lyrique un roman de Zola : Le Rêve. On sait que Bruneau, par l’entremise de Frantz Jourdain, a rencontré Émile Zola en avril 1888. Il voulait lui demander les droits d’adaptation de La Faute de l’abbé Mouret. Zola, ayant déjà donné ses droits à Massenet, lui propose Le Rêve qui n’est pas encore paru. C’est Louis Gallet qui est choisi comme librettiste.
Après le Manifeste des Cinq (écrit en réaction à La Terre), Zola n’échappe pas à l’ironie de certains journalistes qui doutent du succès d’une telle entreprise. Telle cette parodie parue dans Le Figaro du 1er novembre 1888 sous la plume de Albert Millaud :
LA TERRE
OPÉRA COMIQUE
Buteau, baryton, fera sensation dans son entrée au 1er acte. Voici le récitatif qu’il aura à débiter :
Nom de Dieu ! … vraiment je rigole !…
Je te vais lui fourrer quelques bons coups de gaule
A ce Jean … Ah ! Quel muffle ! et je n’en dis pas plus …
Mais vrai, c’est à dégobiller dessus.
Comme on le voit, les librettistes ont cherché à ne pas s’écarter du texte. Buteau poursuit
J’en ai la tête aussi grosse qu’une citrouille …
Mais taisons, car j’aperçois la Trouille.
Arrive la Trouille (Mlle Richard). Elle a une romance délicieuse :
Notre vache vient de vêler,
Ah ! fichtre, ah ! bigre, ah! Quelle vache! …
Il fallait l’entendre gueuler,
J’ai dû leur prêter mon eustache.
Mais c’est le taureau, nonobstant,
Qui s’est offert tout l’agrément.
La parodie continue ainsi, sur ce ton ordurier, pendant plusieurs couplets. Heureusement, dans son ensemble, la presse est plutôt bienveillante et curieuse de voir ce que sera le naturalisme appliqué à la scène lyrique. Eugène Clisson, dans L’Évènement du 2 novembre 1888, rend compte de ses entretiens avec Zola et Bruneau :
« Comment sera échafaudée la pièce ? Comment l’action, comment l’intrigue esquissées de main de maître dans le livre seront-elles produites à la scène ? C’est ce que nous avons demandé à M. Zola :
– Quand M. Bruneau, que je ne connaissais pas, est venu solliciter mon autorisation de transporter le Rêve sur une scène lyrique, nous dit l’illustre écrivain, j’ai trouvé cette idée originale et je n’ai fait aucune difficulté pour lui avouer que j’y avais déjà songé. Je voyais là une tentative intéressante et audacieuse, digne des efforts d’un jeune talent. M. Bruneau qui est, paraît-il, un compositeur de mérite – son titre de prix de Rome en est un témoignage – s’est chargé de la partie musicale et s’est entendu avec M. Gallet, un homme rompu au métier, pour l’adaptation du livret. Dans un mois, on me soumettra le scénario ; jusque là, je veux rester dans la coulisse.
 Ce n’est pas à dire pour cela que je n’aie pas échangé mes idées avec ces messieurs ; mais je leur laisse tout entière la liberté de l’exécution
Ce n’est pas à dire pour cela que je n’aie pas échangé mes idées avec ces messieurs ; mais je leur laisse tout entière la liberté de l’exécution
J’ai reçu, d’ailleurs, d’autres offres qui ne m’ont pas séduit. C’est ainsi qu’un de vos anciens collaborateurs, Georges Duval, vient de m’écrire pour me demander la permission de transformer le Rêve en pièce avec chœurs, comme l’Arlésienne. L’idée n’est peut-être pas mauvaise en elle-même ; elle ne me satisfait pas.
D’autres m’ont proposé de mettre en musique certaines pages – en prose – de mes œuvres, de l’Assommoir en particulier. Un musicien de l’école décadente prétend que les vers constituent déjà une musique, et veut faire un recueil de « morceaux choisis » en prose musicifiée.
[…] Nous nous sommes rendu auprès de M. Bruneau, le compositeur de cet opéra appelé à révolutionner le monde artistique, et dont pas une ligne n’est écrite, pas une note composée.
Grand, mince, barbe noire, lorgnon au nez, œil brillant d’enthousiasme, tel nous avons trouvé M. Bruneau.
Aux questions que nous lui posons, il répond avec une vivacité qui donne la mesure de son tempérament d’artiste.
– Je suis heureux, cher monsieur, nous dit-il, que vous me fournissiez l’occasion de remercier publiquement M. Zola de l’honneur qu’il me fait en m’autorisant à collaborer à cet opéra. C’est une gloire pour moi que le grand écrivain ait bien voulu m’admettre dans l’ombre de la sienne.
En lisant le Rêve, j’ai été frappé du parti musical qu’on pouvait en tirer au point de vue musical. C’est une œuvre merveilleusement appropriée aux tendances de la nouvelle école. […]
Quant à la partie musicale, je ne puis pas vous en parler aujourd’hui. Empoigné comme je suis par cette œuvre, je laisserai parler mon cœur. Je suis un indépendant et je ne me soucie d’aucune école. Naïvement, je tâcherai de rendre mes impressions à moi, sans me préoccuper de l’effet que je pourrai produire sur le public.
J’essaierai de donner à chaque personnage son vrai caractère ; à celui de l’évêque, la souffrance dignement supportée ; à celui de la jeune fille, la grâce, la poésie, le mysticisme, tous ces sentiments que le grand romancier a si magnifiquement interprétés.
Notre opéra, d’ailleurs, sera un vrai drame lyrique moderne ; il touchera d’un côté à la légende, de l’autre au réalisme. […] En résumé, ce sera une pièce « osée de partout ». »
Bruneau prend donc résolument le parti de la modernité et de l’audace. Et c’est cette modernité qui va faire de la création du Rêve un moment clé de l’histoire de la musique. Certains seront très critiques et ne manqueront pas de brocarder Zola, comme Dupont de l’Arc, dans le Monde Élégant du 24 juin 1891 :
AIR : Du charlatanisme
Le Rêve, on en parle partout,
Je ne sais pas ce qu’il renferme,
Les uns le trouvent à leur goût …
Les autres le critiquent ferme !
Vous qui connaissez tout cela,
Dites-moi donc, ma chère amie,
Pourquoi tout ce tapage-là ? …
Quel est le Rêve de Zola ?
Et la commère de répondre, en guise de refrain :
Le rêve d’Emile Zola,
C’est d’entrer à l’Académie ! (bis)

D’autre verront dans cette tentative audacieuse de modernisation du théâtre lyrique le signe d’un compositeur prometteur. C’est le cas d’Ernest Reyer qui, dans le Journal des Débats, s’exprime ainsi sur le talent d’Alfred Bruneau :
« Si, mis au second plan par les hasards du concours, il n’a fait qu’entrevoir de loin les frais ombrages de la villa Médicis où d’autres, plus heureux ou plus favorisés, vont s’inspirer et se recueillir pendant trois années qui sont pour la plupart d’entre eux les trois plus belles années de leur carrière, M. Alfred Bruneau, second grand-prix de Rome, n’en est pas moins un musicien breveté, possédant tout ce qu’il faut savoir pour écrire la partition d’un opéra gai ou sérieux : le nécessaire et même le superflu. Audacieux, il l’est d’avoir prêté des accents lyriques ou passionnés à des personnages en habit de ville :mantelet garni de jais et vestons de velours. Nous voilà, comme vous voyez, bien loin de la légende, de sa poésie et de ses héros. […] Enfin, la partition du Rêve, quoi qu’on en puisse penser, n’est pas l’œuvre du premier venu, ni du dernier non plus, car tenez pour certain qu’il en viendra d’autres après celui-là. Mais est-ce là, comme quelques-uns l’affirment, et bien que certains procédés particuliers à Richard Wagner y soient employés, une œuvre wagnérienne ? Je ne le pense pas. »
Reyer avait raison puisque, après cet opéra, Bruneau va en écrire dix autres dont la plupart seront composés en collaboration avec un Zola devenu librettiste (Messidor, L’Ouragan, L’Enfant-Roi, Lazare) ou tirés de ses propres œuvres (L’Attaque du Moulin, La Faute de l’abbé Mouret, Naïs Micoulin, Les Quatre Journées).
Bruneau, tout au long de sa carrière, va recueillir l’admiration et les félicitations de ses pairs. Isaac Albeniz, compositeur espagnol, livre sa passion pour Bruneau dans une lettre du 21 février 1897 :
« Monsieur,
Je vous connais et par vos œuvres et par vos écrits, je sais que vous êtes un homme à qui l’on peut dire la vérité sans qu’il se froisse si elle est amère et sans qu’il la prenne pour indigne flatterie si elle est douce. Et bien Monsieur, permettez-moi en ma qualité de « quasi collègue espagnol » (et je dis « quasi » pour cause) de vous faire parvenir le profond sentiment d’admiration que votre Messidor a produit en moi !
Aveugles (comme nous le sommes tous) par l’irradiation du génie de Wagner, parvenir à faire une œuvre comme la vôtre, cela dépasse les bornes du simple talent ; expliquez-vous donc l’[entête] qui est au bout de ma plume, et que je n’écris pas, de crainte de favoriser votre modestie ; mais je le pense Monsieur, je le pense avec toute mon âme, et au lieu d’en être jaloux, j’en suis en pleine jubilation ; la décadence de l’Art musical n’est désormais qu’un vain mot. »
Même ses adversaires acharnés, comme le critique musical Camille Bellaigue, trahissent leur admiration sous les attaques :
« Vous êtes décidément un homme hors ligne ! et le second musicien seulement avec lequel il y ait plaisir à se battre (d’Indy est le premier, soyez encore fier de votre place !) et ferai relier votre correspondance.
Oui, vous êtes menaçant et plus je relis votre partition plus elle me met en colère ! Oh ! que je vous en citerais des passages et des pages que je maudis !! J’en trouvais hier soir encore à la douzaine. Quand donc passerez-vous sur le chemin de Damas ; quand le Beau vous criera-t-il en vous renversant : Alfred ! Alfred ! Alfred ! pourquoi me persécutes-tu !
Alors vous écrirez toujours comme : Et je pleure à vos pieds ou bien : Seigneur, je viens vers elle plein de sincérité ! ou bien toute la phrase : Je tiens de ce métier une sagesse et un art.
Horreur ! Horreur ! Ni comme les cors qui font les cloches au tableau de la procession ! Fi ! Fi ! Pouah ! etc… etc … oh ! oui, etc !
Allons, cette fois, c’est ma dernière lettre. Qui sait, dans 40 ans peut-être j’aimerai passionnément Le Rêve ! Mais alors j’aurai 73 ans et l’on m’appellera déjà gâteux.
Adieu, Delescluze de la musique (Courbet, me répondrez-vous). Je vous déteste et vous estime. »

Le grand ami de Bruneau, Emmanuel Chabrier, voit dans cette association avec Zola une « idée de génie » : (Lettre du 31 octobre 1888)
« Bravo, Bruneau , bravo, Alfred, bravo, mon vieux ! Vous avez eu une idée de génie, car c’est un ouvrage joué, et sûrement et à brève échéance ! chic ! chic ! chic ! Et ce que ça va embêter du monde ! rechic ! rechic ! rechic ! Hop là ! au travail. Mais ne vous pressez pas trop néanmoins camarade. Que ce soit du nanan ! et le nanan ne se rencontre pas tous les jours ; avec ce titre, avec Zola, avec Gallet, vous pouvez être convaincu qu’on voudra voir aussitôt que le mot fin aura été mis au bas de votre partition. Donc, hâtez-vous lentement. Je suis ravi pour le papa, pour la jeune épouse, pour vous et pour ce cochon d’art que nous aimons tant. »
Et nous pourrions également citer les éloges de Debussy, Strauss et Malher … Même Verdi a pu dire à Bruneau l’admiration qu’il avait pour son travail. Cette rencontre est relatée dans Gil Blas du 11 mars 1893 par André Corneau :
« La porte du salon s’ouvrit. Et, précédé du chanteur Maurel, quatre journalistes français entrèrent. Verdi courut à leur rencontre : c’étaient Darcours du Figaro, Bauer de l’Écho de Paris, Alfred Bruneau du Gil Blas, et un autre. Après s’être fait présenter les visiteurs, le compositeur au poil blanchi par les succès leur offrit des sièges et, avec une bonne grâce exquise, s’entretint avec eux.
Solidement assis dans son fauteuil, les pieds emprisonnés dans de lourds souliers de montagnard, appuyés fortement au plancher, Verdi parlait, l’œil doux et le sourire aux lèvres.
Sa personne respirait la quiétude parfaite et un ravissement empreint de sérénité. S’exprimant avec circonspection, il disait, d’une voix très sonore encore, de bonne choses comme un homme qui a beaucoup vécu, beaucoup médité et beaucoup vu.
Bruneau surtout l’attirait. Il s’informait de ses travaux, de ses projets d’avenir.
– « Ah ! Si je pouvais être à Paris quand on donnera votre prochain ouvrage, je voudrais tant l’entendre ! Travaillez, c’est si intéressant le travail ! »
Ce grand laborieux entourait Bruneau de tendres regards dans lesquels on pouvait lire le regret de ne pouvoir bientôt plus produire. C’était le passé en présence de l’avenir. Rien de plus touchant que cette réception faite par Verdi à un compositeur qui, certes, ne suit pas le sillon italien.

Le vieil artiste accueillait le jeune artiste sans se préoccuper du soin de savoir ce qu’il pensait. Et c’était simple et beau, je vous jure, ce spectacle offert par cet octogénaire triomphant ne dédaignant pas un musicien encore à l’aurore de sa carrière. On dira que lorsqu’on plane sur les cimes, il est facile de se montrer aimable envers les nouveaux venus. Oui, sans doute ; mais n’est-il pas juste de reconnaître que la chose n’est pas si commune que cela ? »
Enfin, citons le précieux travail d’enquête mené par Jan van Santen Kolff. Ce correspondant néerlandais de Zola avait à cœur de connaître les projets de l’écrivain afin d’en pouvoir offrir la primeur à ses lecteurs. Il menait ses enquêtes en correspondant régulièrement avec Zola. Il fit de même avec Alfred Bruneau. Ce qui nous laisse des lettres du compositeur dans lesquelles il livre ses intentions au moment de composer ses opéras. Voici un extrait d’une lettre de Bruneau à van Santen Kolff écrite le 16 juin 1892, un an avant la création de L’Attaque du Moulin :
« Dans le Rêve, nous n’avions que cinq personnages, pas de chœurs proprement dits c’est-à-dire sur la scène), pas de figuration, et je m’étais astreint à une grande discrétion instrumentale. Dans L’Attaque du Moulin, nous avons du monde, toute une polyphonie vocale avec de beaux et puissants effets d’orchestre. Puis, c’est un sujet français, bien français, encore plus français que n’était le Rêve. Mais pas de tirade patriotiques, pas de revendications chauvines. Rien que le drame humain et émouvant, commencé dans la grande paix joyeuse des champs de notre pays et se continuant dans l’indicible tristesse de l’invasion. Dans le Rêve, j’ai mis bien des souvenirs de première communion, de mysticisme enfantin gardés au fond de moi-même ; dans L’Attaque du Moulin, je mettrai des impressions de la terrible guerre, enfouies aussi au fond de mon cœur depuis vingt et un ans.
Et la pièce, telle qu’elle est faite, ne peut blesser personne. Chacun y agit comme il doit agir, et fait son devoir. Pas une fois, on n’y parle des Prussiens ou des Allemands ; nous nous servons d’un seul terme : l’ennemi. Nous ne montrerons point des casques à pointe et nous habillerons nos divers soldats de façon à ne froisser aucun sentiment respectable. Et pas un coup de fusil ne sera réellement tiré en scène. L’orchestre, je l’espère, donnera une suffisante impression du combat.
En somme, j’applique à un autre sujet les idées que je vous exposai, il y a quelques mois, à propos du Rêve. Je me transporte dans la vie contemporaine, et j’essaie de faire chanter les passions, les joies, les douleurs de mon temps et de mon pays, pensant exprimer mieux ces sentiments-là que d’autres, et bien heureux, bien fier, de tenter cela avec l’aide si affectueuse et si puissante du grand maître que j’aime et que j’admire profondément. »
Nous pourrions citer bien d’autres articles intéressants. La presse de l’époque a consacré à Bruneau et Zola des centaines d’articles et d’entrefilets. Il s’agissait ici d’en citer quelques-uns afin de montrer qui était Bruneau et ce qu’il avait souhaité faire en collaborant avec Émile Zola. Laissons, en dernier lieu, la parole à René Dumesnil, musicologue français, qui résume avec des mots justes la carrière et la personnalité de Bruneau, tout en n’oubliant pas la figure tutélaire de Zola :

« Il y a trois ans qu’Alfred Bruneau nous a quittés.
Trois ans … Il ne semble cependant qu’un si long espace nous sépare déjà des derniers jours qu’il passa parmi nous. Encore maintenant, il nous arrive quand nous entrons dans une salle de concert, de le chercher des yeux à la place qui était la sienne, et, vraiment, son souvenir demeure si vif et si précis en nous, que nous ne nous habituons point à l’idée d’une séparation définitive. C’est un privilège réservé à quelques-uns qui furent non seulement des esprits d’élite, mais aussi les meilleurs d’entre les hommes, que cette survie dans la mémoire de tous ceux qui les approchèrent. C’est un privilège et c’est sans doute une grande douceur, au moins pour ceux qui restent. Le mort qu’ils pleurent, ils savent qu’il peut traverser cette période d’exil, où les morts attendent d’entrer dans l’histoire, un temps qui est comme une épreuve plus dure que les épreuves de la vie, le temps que la postérité emploie à faire son choix, un terme au bout duquel viendra pour le plus grand nombre une seconde mort, et puis, pour quelques élus, une nouvelle vie où leur visage apparaîtra « tel qu’en lui-même enfin l’éternité le change ». Pour ceux-là si leurs traits peuvent demeurer non point figés et durcis mais conservant quelque chose du chaud rayonnement de la vie, c’est à ce privilège qu’ils le doivent, c’est parce qu’ils surent être, tant qu’ils vécurent, assez dédaigneux des choses périssables pour que la mort, en définitive, n’ait point grand chose à enlever de ce qui fut leur personne et de ce qui devient leur souvenir.
Ainsi, l’œuvre d’Alfred Bruneau apparaît-elle, elle aussi, sans être ternie par les ans. Dès 1917, au lendemain de la reprise de Messidor à l’Opéra, M. Pierre Lalo écrivait dans Le Temps : « Il est curieux de voir reparaître au jour une œuvre qui était demeurée dans l’ombre pendant vingt ans. Quelle figure va-t-elle faire devant ses nouveaux spectateurs, quels changements va-t-on trouver en elle ? Que va-t-il s’y révéler de suranné, de périssable, ou de durable et de vivant ? L’épreuve laisse Messidor à peu près intact. Il m’apparaît aujourd’hui semblable à ce qu’il était autrefois. Cela tient à plusieurs causes, dont la principale est sans doute celle-ci : M. Bruneau a toujours été fort étranger aux modes et divertissements divers qui se sont succédé dans notre musique depuis un quart de siècle. Si tout au début de sa carrière, il nous a montré qu’il était l’élève de Massenet, il s’est vite dégagé de cette influence, qui, déjà, dans Le Rêve n’est plus qu’un souvenir … Depuis qu’il a commencé de prendre conscience de sa personnalité, il écrit la musique qu’il portait en lui et qu’il était fait pour écrire. Il ne s’est point laissé détourner de sa voie par les tentations de l’exemple ni par celles du succès. Il a suivi tout droit son chemin, et cette droiture a sa récompense : l’œuvre qu’elle a inspirée supporte le poids des années, auxquelles succombent tant d’autres œuvres plus inquiètes de réussir, et qui se croyaient plus habiles … »
 Le mot droiture définit à lui seul le caractère de ce noble et bel artiste que fut Alfred Bruneau. Il n’a menti jamais ni à lui-même ni à autrui. Il a été, comme le disait le critique du Temps, volontairement sourd aux tentations du succès, il a su demeurer étranger aux modes passagères, il n’a jamais voulu rechercher les sourires de la fortune et si le succès est venu quand même, si la fortune a souri, c’est que, parfois, l’énergie et l’honnêteté, la sincérité sans complaisances sont aussi un moyen de réussir. N’être jamais de ceux dont on dit qu’ils sont habiles, c’est parfois une grande et involontaire habileté. Ainsi la postérité vous reconnaît, vous adopte et vous aime. Cette droiture, qui fut celle d’Alfred Bruneau, j’y retrouve exactement ce que Flaubert a si bien dit dans une réponse à Maxime Du Camp qui les pressait d’arriver : « Être connu n’est pas ma principale affaire. Je vis à mieux, à me plaire. Le succès me paraît être un résultat, non pas le but … » Pour Alfred Bruneau, le succès ce fut le résultat du labeur consciencieusement accompli sans souci aucun des profits immédiats, sans concessions aux modes passagères.
Le mot droiture définit à lui seul le caractère de ce noble et bel artiste que fut Alfred Bruneau. Il n’a menti jamais ni à lui-même ni à autrui. Il a été, comme le disait le critique du Temps, volontairement sourd aux tentations du succès, il a su demeurer étranger aux modes passagères, il n’a jamais voulu rechercher les sourires de la fortune et si le succès est venu quand même, si la fortune a souri, c’est que, parfois, l’énergie et l’honnêteté, la sincérité sans complaisances sont aussi un moyen de réussir. N’être jamais de ceux dont on dit qu’ils sont habiles, c’est parfois une grande et involontaire habileté. Ainsi la postérité vous reconnaît, vous adopte et vous aime. Cette droiture, qui fut celle d’Alfred Bruneau, j’y retrouve exactement ce que Flaubert a si bien dit dans une réponse à Maxime Du Camp qui les pressait d’arriver : « Être connu n’est pas ma principale affaire. Je vis à mieux, à me plaire. Le succès me paraît être un résultat, non pas le but … » Pour Alfred Bruneau, le succès ce fut le résultat du labeur consciencieusement accompli sans souci aucun des profits immédiats, sans concessions aux modes passagères.
C’est une grande chose aussi d’avoir été un de ces hommes dont on ne prononce jamais le nom sans rappeler qu’ils furent liés à un autre homme, par l’esprit et le cœur –un de ces hommes dont le nom illustre demeure joint à un autre nome illustre par le mot le plus beau qui soit, le mot ami. Ainsi on dit, ainsi on dira toujours Bruneau et Zola qui furent amis. L’amitié menée à un point de perfection est aussi une œuvre d’art : elle est faite de soins incessants. Elle veut des qualités qui n’appartiennent pas au commun des hommes. Elle n’éclot qu’en certains cœurs privilégiés, et, pour croître jusqu’à donner tous ses fruits- ici, les fruits magnifiques ont pour nom le Rêve, L’Attaque du Moulin, Messidor, L’Ouragan, L’Enfant-Roi… – Il lui faut s’épanouir ensoleillée de cette tendresse virile, baignée de bonté aux heures d’épreuves où deux courages s’unissent pour étayer leurs fardeaux.
L’histoire de cette amitié, c’est celle qu’Alfred Bruneau a contée lui-même dans ce livre magnifique qui, précisément, a pour titre À l’ombre d’un grand cœur. Mais est-ce bien à l’ombre de Zola que Bruneau a vécu, travaillé, donné lui aussi ses grandes œuvres ? N’est-ce pas bien plutôt que ces deux grands artistes ont projeté l’un sur l’autre les bienfaisantes et chaudes lumières d’une entente, d’une compréhension et d’un dévouement que les années, en passant, n’ont jamais fait qu’aviver ?
Auprès de Zola, Bruneau s’est pleinement réalisé lui-même. Il a courageusement accompli son destin. Il a su affranchir le théâtre lyrique de bien des conventions gênantes. Il a élargi les limites où se tenaient enfermés, par tradition, les librettistes et les musiciens. L’audacieux Alfred Bruneau a tranquillement osé ce que nul autre avant lui n’aurait cru possible. Il a osé et il a réussi, et il a fait mieux encore puisqu’il a su donner à ses œuvres d’audace le caractère des ouvrages essentiels à l’histoire de l’art, le caractère des chefs d’œuvre qui ne doivent pas mourir.
Il avait atteint la vieillesse en demeurant jeune d’esprit et de cœur. En le voyant si assidu, toujours aux devoirs de sa charge de critique, nous n’imaginions point qu’il dût si tôt quitter l’admirable femme qui fut l’attentive compagne de sa vie, et, par sa mort, causer à ceux qui l’aimaient, le seul chagrin qu’il leur ait fait. Hélas, bientôt devait le rejoindre ici son gendre René Puaux, venu reposer tout près de lui, pour prolonger par ce voisinage dans la mort la longue affection de la vie … »
Discographie :
– Messidor, Naïs Micoulin, L’Attaque du Moulin, Alfred Bruneau ; Orchestre Philharmonique de Rhénanie-Palatinat ; direction, James Lockhart, Naxos, 1993
– Requiem, Lazare, Alfred Bruneau ; Orchestre National d’Ile-de-France ; direction, Jacques Mercier, RCA et BMG, 2000.
– Visions (avec l’introduction de Geneviève d’Alfred Bruneau), Véronique Gens, Palazzetto Bru Zane pour Alpha Classics, 2017.
– La Nuit de Mai, Alfred Bruneau ; Cyrille Dubois, Jeff Cohen, Vincent Figuri, Quatur Varèse, Marie Normant, Jens Mc Manama, Quatuor Anches Hantées, Salamandre, 2020.